CONCLURE POUR DÉPASSER LA POLÉMIQUE.
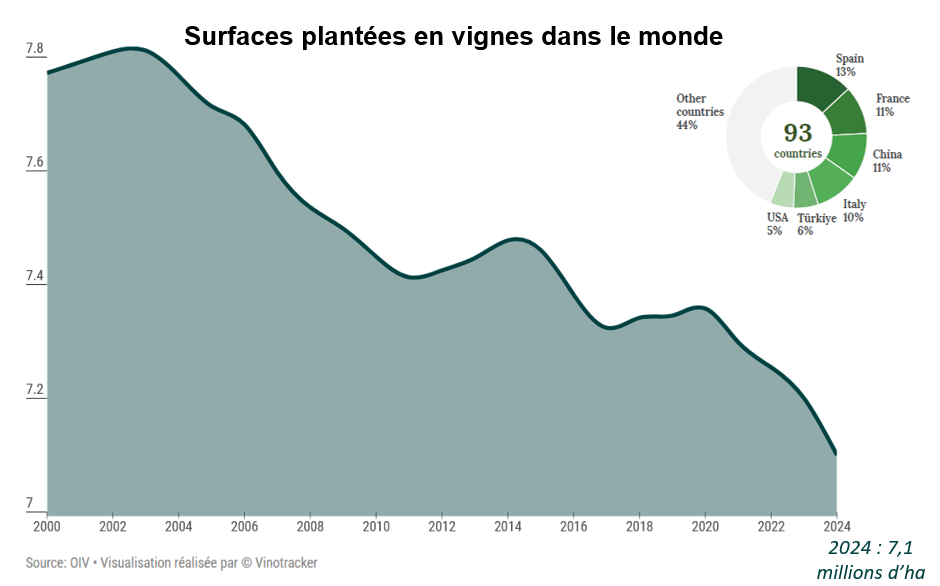
On peut débattre de la pertinence de cette opération menée par Vin & Société, mais il faut ici souligner ses effets. En focalisant l’attention sur les aléas économiques, on occulte ainsi d’autres acteurs clés de l’évolution de la vente des vins, tels les consommateurs en eux-mêmes, pourtant au cœur même de la définition même de « déconsommation ». Cette définition doit être connue des acteurs qui aujourd’hui se font les chantres d’une communication alarmiste : leur recentrage identitaire est, en quelque sorte, une manière de souligner l’importance d’un patrimoine local où le vin jouerait une place essentielle.
Ce faisant, si cette stratégie répond aux attentes de proximité et d’authenticité recherchées par une partie des clients, elle en néglige toutes les autres, et détournent de solutions qui prendraient en compte la réalité des ventes, dans des analyses plus fines et moins orientées, capables, peut-être, de toucher un public plus large. La preuve de cet égarement s’incarne là encore dans ce mot porteur de « déconsommation ». Si nous avons souligné ici son emploi massif dans la filière viticole depuis 2020, et agricole depuis au moins 2014, le mot en lui-même ne cessa d’être un néologisme qu’en 2022, quand il entra dans le dictionnaire Robert, et demeure un terme rare, peu connu du grand public : une recherche sur Google Analytics montre que le mot ne dépassa que rarement la centaine de recherche, et ce précisément en 2019 et 2020, avant de retomber dans une relative indifférence. La « déconsommation », si c’est un phénomène réel et observable par les sciences de la gestion depuis maintenant une vingtaine d’années, n’est pas identifiée comme tel par les principaux intéressés, les consommateurs, qui en ignorent tout. Les discours alarmistes des acteurs du monde du vin ne sont, au final, qu’une tempête dans un verre d’eau.
Sociologie du mensonge.
Alors quelles leçons tirées de la « déconsommation », phénomène créé de toute pièce par des données lacunaires, interprétables comme des intox ? Tout d’abord qu’il faut se méfier des solutions trop faciles : les crises économiques ont des impacts réels, mais elles ne s’incarnent pas toujours dans une baisse de la consommation. La réalité sociologique est autre et c’est là un des principaux enseignements de cette histoire. Le vin, en tant que produit, est soumis à une combinaison potentiellement infinie d’attentes de la part des consommateurs. N’étant plus, depuis longtemps, un pur produit de nécessité, une boisson alimentaire, il faut donc savoir tenir compte des valeurs que lui attribuent les consommateurs, en positif comme en négatif, afin d’y répondre et d’adopter des solutions commerciales adaptées, elles-mêmes multiples. À ce train-là, nous accusons un train de retard sur les sciences de la gestion et du marketing, qui depuis maintenant des décennies ont pris en compte l’agentivité* du client en compte. Il est ainsi flagrant de noter que tandis que les médias répètent et font entrer pleinement dans la langue française le mot « déconsommation », son verbe, « déconsommer », est absent du champ médiatique et même grammatical, preuve une fois de plus de cette conception passive d’une économie que l’on est censé subir, et non sur laquelle tous les acteurs, producteurs comme consommateurs, ont le pouvoir d’agir.
* capacité des individus à être maîtres, « agents », de leur existence (voire de leurs comportements et de leur réussite économique).
Cette série d’articles a été co rédigée avec Roxane Chaudier, maîtresse en histoire, Université Paris Cité.
Retrouvez tout le dossier : Déconsommation, histoire d’un mythe.












