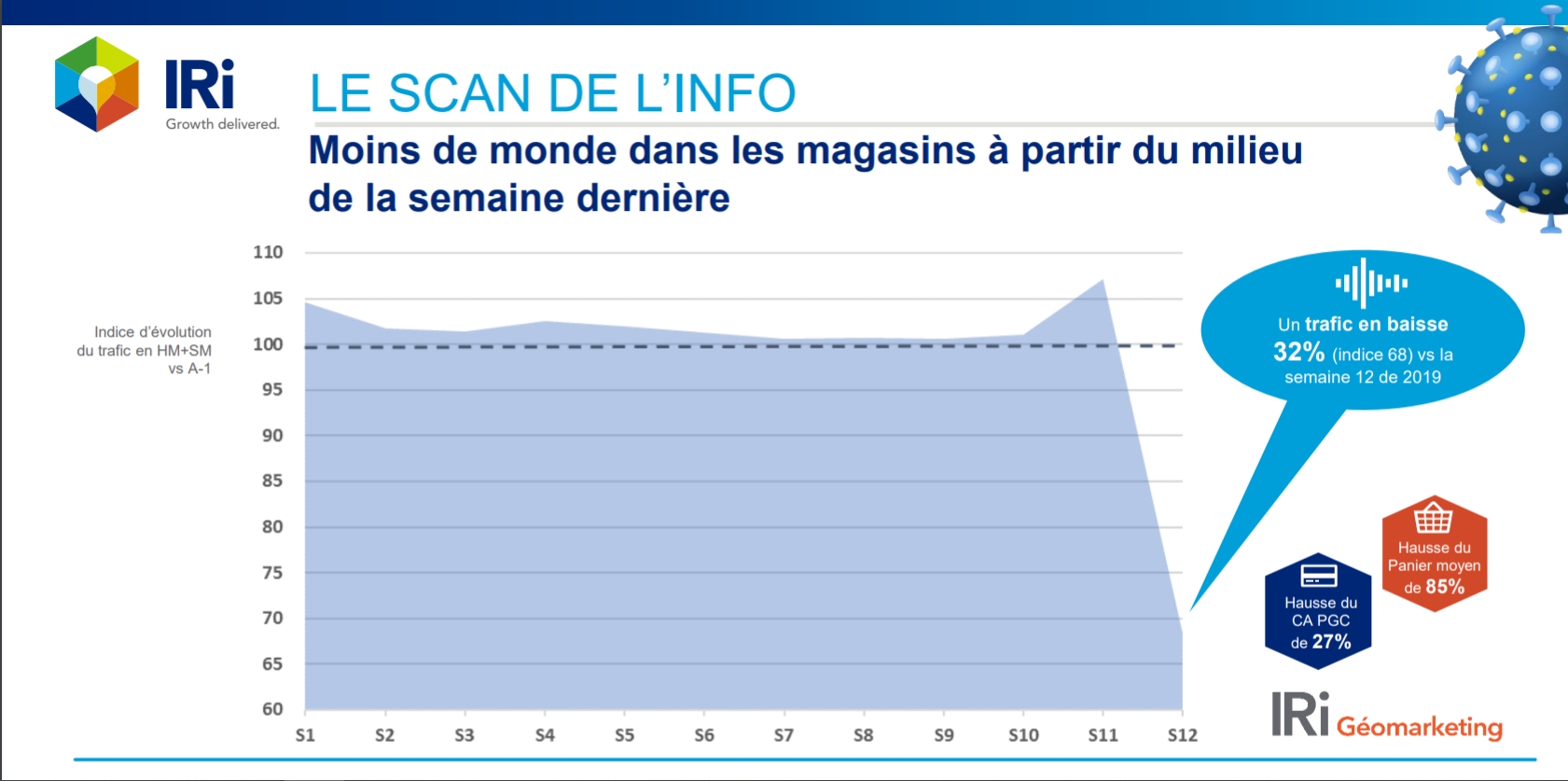POURQUOI LES ORIGINES NE FERAIENT-ELLES PLUS RÊVER ?

Une histoire de qualité.
Cet article présente un compte-rendu de la conférence de Sylvaine BOULANGER, Maître de conférences HDR en géographie rurale et de l’alimentation à Sorbonne Université.
Depuis leur création et les évolutions législatives successives (loi d’orientation agricole de 2006 et réforme de l’organisation du marché du vin 2007, par exemples), les signes d’origines dominent la viticulture française : les 360 AOP (ou AOC, appellation d’origine protégée européenne ou contrôlées française) pèsent 58% quand leurs homologues « régionales » IGP (indication géographique protégée) dépassent le tiers de la production. Les vins sans aucune indication (vin de France) n’en représente plus que 7%.
Cette longue démarche, fruit d’un travail collectif officialisé dans un cahier des charges, défendu par un ODG (ex-syndicat) repose sur trois dimensions en interaction, agronomique, sociale et identitaire (culture, patrimoine, paysage) ; la notion de terroir bien que flou en termes géographiques (définie comme toute portion du territoire non bâti ; tout est donc terroir) en est devenue l’axe principal de communication.
Pensée comme une mise en valeur par l’homme du potentiel agronomique de son milieu (sol, sous sol, climat, exposition), l’appellation symbolise son savoir faire alliée à l’histoire. Le produit qui en est originaire et ainsi désigné, se définit donc par la qualité ou les caractères sont dus à son milieu naturel.
Même si leur utilisation sur les bouteilles de vin reste confidentielle, les logos AOP et IGP massivement communiqués pour l’ensemble de l’agriculture ont impacté la reconnaissance par le consommateur de l’origine comme signe distinctif de qualité.
Une crise de confiance des vigneron.nes.
Dès le début des années 2010 et de façon récurrente, des articles sur le bashing des AOP se positionnent en faveur des sans IG : loin de signifier un désamour du marché, cette attaque du fondement même de l’image des vins vient d’une remise en question du modèle par les producteurs.
Les points d’achoppement sont nombreux :
-l’évolution de la typicité de nombreux vins liés aux démarches environnementales (naturels, bio et biodynamiques), aux petits rendements, à des techniques de vinifications (sans filtration ou sulfites) brusque les dégustateurs des ODG. Ces vins écartés de l’agrément, sont « déclassés » en vin de France.
-la standardisation. Au-delà, la normalisation des cahiers des charge des AOP a pu conduire à un écrasement de l’identité (tous les vins tendent à se ressembler) et à une moyennisation.
Concilier caractère commun et originalité devient impossible ; les tensions au sein des territoires se multiplient.
-le prix. Subi plus que choisi, le repli vers les catégories les plus basses de la pyramide, est imposé par les négociateurs des circuits de masse : il est plus facile à leurs yeux de vendre par le (premier) prix que par l’explication (marketing) des différences subtiles entre chaque terroir.
-la gouvernance. La rigidité du système et le poids du collectif où chaque changement, chaque décision s’applique à tous, bloque psychologiquement les vigneron.nes qui veulent innover et avancer plus vite.
En résumé, le repli vers les vins de France est de plus en plus volontaire, vécu comme une « liberté » : lassitude ou signe d’un individualisme décomplexé – volonté de créativité (raconter son histoire), choix des cépages (oubliés, hybrides) ou des rendements, complantation ou agroforesterie) – il accélérer le rythme du travail aussi tourné vers des débouchés économiques plus évidents.
Cette stratégie de distinction recrute de nouveaux consommateurs, élabore des vins de qualité révélant mieux leur terroir, plus et mieux marketés (naturels, biodynamiques) et sécurisés en volume par des achats extérieurs.
Ne pas jeter l'origine.
Attention au mirage d’une solution unique et facile : si seul on va plus vite, ensemble, ne va-t-on pas plus loin ?
L’AOP, base de la renaissance de certaines régions, reste un élément de distinction qui dans un temps long, prouve sa réussite. Si elle peut être perçue en amont comme une de rente qui amène à ne plus faire d’efforts (la garantie administrative est réelle), elle distingue les vins dans une pyramide de l’offre vs les IGP et les vins sans IG, que valide les consommateurs.
L’AOP protège et fait encore rêver, beaucoup la réclame. Encore faut-il réussir à la vendre, donc à l’expliquer (relire « Les consommateurs n’ont pas à parler la langue des experts« ).
Les enjeux sont donc de se mettre en accord sur la redéfinition des cahiers des charges (plus exigeants ou plus light ?), sur la montée en qualité des les producteurs les plus en retard, sur la capacité à dégager de la valeur ou sur la place des marques. Car, la vocation des vins de France n’est pas de faire de la qualité mais de libéraliser la production. Innover dans le collectif, se renouveler, voilà le défi à relever pour les AOC.