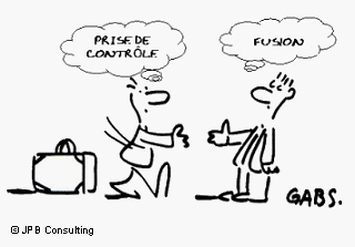LE RÊVE DU REVENU GARANTI.

De quoi parle-t-on ?
Le prix plancher se définit comme une notion économique de « niveau en dessous duquel un vendeur ne peut baisser du fait de ses coûts, et en dessous duquel il préfère renoncer à la vente. » Il devient « prix minimal » quand il est « fixé par la puissance publique pour un type de produit ».
Dans un cadre libéral, c’est-à-dire de marché concurrentiel, le prix tient du rapport entre acheteur et vendeur : rapport de force quand il se déséquilibre au profit d’un seul (situations de monopole ou distorsion de puissance d’un des acteurs), rapport d’équilibre entre besoins et propositions de l’offre quand il s’inscrit dans une négociation ouverte.
Pour éviter ces dérives et déséquilibre, le droit s’est emparé du moment de la vente pour établir des barrières : la base de la règle commerciale générale tient dans l’interdiction de vente à perte, établie dans la loi française (depuis 1963) et européenne (la Cour de justice de l’Union européenne l’ayant confirmé le 19 octobre 2017 de façon générale).
On peut donc constater l’échec de l’application de la loi dans le monde agricole : dans les rapports nord – sud comme aujourd’hui à l’intérieur des pays du nord où les producteurs ne cessent de s’appauvrir.
Des solutions ont été mises en place au travers par exemples de la Politique Agricole Commune (européenne) qui compense par la subvention le revenu agricole non généré par la vente ou de la labellisation équitable qui garantit un prix plancher réel (c’est-à-dire adossé au coût de production. Mais on voit bien la limite de ses systèmes : le premier acte l’impossibilité de vivre de son travail ; le second fige la valorisation à un niveau pré défini. Les deux entretiennent les paysan.nes dans une dépendance qui leur paraît de façon légitime de moins en moins tolérable.
Comment agir ?
On peut défendre une thèse plus libérale encore de dérégulation et d’allègement des charges et contraintes pour produire. Cependant les effets automatiques et positifs ne s’ancrent dans aucune historicité ; au contraire, de nombreux contre-exemples agricoles existent.
Ainsi pour le lait, la protection de l’AOP, la réglementation qui empêche un opérateur de détenir plus de 50% de la production sur la zone d’appellation, ont permis (entre autres) aux producteurs de reblochon ou de conté d’être payés deux fois (parfois trois fois) plus que ceux de lait « générique » (0,8€ mini le litre contre 0,4€ acheté par Lactalis ou les coopératives comme Sodiaal, et les 0,5€ qui semblent correspondre aux coûts).
Dans d’autres domaines, le bio et les circuits courts assurent la pérennité économique de beaucoup de paysans.
On peut alors décrire les exemples de réussites dans le vin (caves particulières ou coopératives) qui viennent des choix de stratégie clairs posés par les structures et de la maîtrise de leur commercialisation ; pas de solutions toutes faites, pas de modèles mais une responsabilisation qui englobe au sein de l’entreprise, tous les métiers y compris ceux délaissés ou mal connus de l’aval.
Mais aucune évidence ne s’impose pour établir une politique collective, un commun qui porte à la fois du sens et rende possible la pérennité de l’agriculture.
Appliquer la loi.
Pour la viticulture (comme dans le reste de l’agriculture), la notion de prix plancher est une chimère parce que l’on ne peut comparer plusieurs produits qui portent pourtant le même nom ; plus encore, produit transformé par le producteur, le vin n’est plus assimilé par le consommateur comme une boisson alimentaire.
Dans ce cas, comme souvent, revenir à l’esprit de la loi, de ceux qui l’ont imaginée, peut s’avérer simple et efficace : le prix plancher ne se trouve pas précisé, seul existe l’interdiction de revente à perte.
Respectons la loi ! Trouvons la base de son application.
Des chambres d’agriculture régionales ou départementales publient depuis plusieurs années, un référentiel économique du vigneron. Elles peuvent difficilement être accusées de partialité. Elles fixent en fonction de parcours techniques différenciés, selon la type de structure (surface, rendement) et de mise en marché (directe, bouteilles, vrac, mixte), le coût de revient de l’hectolitre, de la bouteille.
Reconnaissons l’excellence de ce travail, donnons-leur si nécessaire plus de moyens pour l’affiner encore et nous obtiendrons un prix seuil de revente à perte que les acteurs des filières se devront de respecter.
Ainsi pour le vignoble bordelais de Gironde, le prix minimum (du parcours le moins cher) ‘établit pour 2022 à 1 295€ le tonneau (144€ / hl) pour le conventionnel et 1 826€ (203€ / hl) pour le le bio. Voilà de quoi fonder une « revendication » simple et accessible.
Sortir de l'affrontement.
L’attention se focalise sur la grande distribution et sur le négoce, cibles de procès ou de dénonciation.
La première ne pèse plus que 35% du marché du vin en France ; dernier maillon de la filière, lestée par sa chute actuelle et la posture de beaucoup d’enseignes (se limiter aux 1ers prix et MDD), elle apparaît comme une sorte de bouc émissaire facile et masque les vraies responsabilités. Le second a été pointé du doigt avec justesse certes mais sur des dossiers qui concernent des entreprises filiales de … coopératives ! ‘Café de Paris’ fabrique sa marque d’effervescents ‘produits en France’ avec une base de vin espagnol (elle appartient au groupe Invivo via sa filiale Cordier, la même condamnée en première instance par le tribunal de Bordeaux pour des prix d’achat trop bas).
Alors, on continue à se faire la guerre entre opérateurs français ou on se concentre sur l’avenir, la sécurisation des prix par la loi ?